Alain Finkielkraut, un ami qui vous veut du bien, même malgré vous, même si vous criez au secours. Ici aux côtés de Michel Foucault...
Changement d'adresse du site : http://www.freakosophy.com
Le philosophe introspectif qu’est Finkielkraut a sans doute ses raisons de dire qu’il ne sait pas qui il est. Je ne suis pas plus à l’aise que lui avec l’idée qu’il faille absolument défendre qui l’on est ou faire de la proclamation de son identité un grand show télévisé – NRJ12 nous a mis en garde. Qu’on le veuille ou non le travail intellectuel consiste souvent à penser contre soi-même, à jouer la duplicité, et même à y prendre plaisir. Mais ce qui me met personnellement très en colère est de voir avec quelle facilité Finkielkraut règle le destin identitaire des autres : femmes, pédés/gouines/trans, immigrés en France (qui sont majoritairement européens, je le rappelle ici) ou musulmans par choix ou par héritage culturel… Dans tous ces cas, Finkielkraut ne fait pas la dépense d’une dialectique aussi onéreuse. Leur identité pour lui est très claire.
Pourtant, il ne croit ni à la tradition, ni à la possibilité de constituer une nouvelle culture à partir d’une insulte préalable. Comment désigner son interlocuteur sans faire le pari de le connaître par avance ? Et on est d’accord, c’est très embêtant dans la vie de tous les jours de ne pas pouvoir désigner l’autre (raison pour laquelle les préjugés restent un outil difficilement dispensable). La stratégie de Finkielkraut est à l’avenant :
- pour les minorités LGBT, elles sont méchamment inexistantes. Elles sont les simples excroissances d’une mauvaise foi sartrienne qui aurait métastasé un peu trop longtemps dans le corpus de la queer theory.
- Pour les musulmans, en revanche, il lui semble assez clair que leur identité peut être assignée à une origine traditionnelle (sur ce mode, Onfray le rejoint tout à fait, pour dire qu’il suffit de lire le Coran pour dire à un musulman ce qu’il est supposé être).
- Quant aux femmes, à en croire la persistance de Finkie à dénoncer la théorie du genre, elles semblent avoir pour lui une nature et un destin de procréation qui les sauve de la terrible question de savoir qui elles sont.
Autrement dit, d’un coup, quand on parle des autres, il n’y a plus de logique. Et on ne peut pas se retenir de penser que cette soudaine incohérence est la définition même du racisme, de l’homophobie, ou du sexisme.
Son positionnement global est incohérent depuis longtemps. Je veux bien qu’il ne soit qu’agrégé de lettres, mais il aurait pu faire un effort de systématisation.
Dans une émission du cercle de minuit de 1996, il intervient à titre d’ami de Frédéric Martel et de Michel Foucault, autrement dit en tant qu’ami de pédés. Pourtant, il ne lui faut pas deux secondes pour aussi larguer tout ce qu’il a de boules puantes sur la communauté gay de l’époque qui sort à peine du sida. Pour dire que la notion de communauté gay est une fiction dangereuse, il accuse de façon ignominieuse les homosexuels d’avoir facilité la contagion par transfusion sanguine sous prétexte qu’ils ne voulaient pas être discriminés des dons – alors que la responsabilité de l’affaire du sang contaminé échoit à l’état qui refusait de faire dépister les donneurs, ou d’empêcher le sang contaminé d’être chauffé. D’autant que le retard du test en France n’avait pas beaucoup de motifs vertueux. Il fallait empêcher le concurrent américain du test de dépistage français, Abbott, de débarquer sur le marché français… Bref, learn your history, idiote. Alors on montre à Finkielkraut des images de combats communs contre l’homophobie. Mais rien n’y fait. Le sida, la communauté, les revues, les actions concertées… Tout est là. Pour ne pas le brusquer, Eribon se refuse à faire de la mythologie, il veut être historien, se contenter des faits.
Mais tout ça reste déjà trop inauthentique pour Finkielkraut. Ces faits sont pure facticité, pure contingence. Pas d’identité sérieuse. Pour lui, l’identité gay contemporaine se résume à être le résidu de la sexologie du 19ème siècle, et toute identification en tant que telle, est une preuve de mauvaise foi. En s’autorisant de Foucault, il essaie en toute mauvaise foi de dire que l’homosexuel est une « solidification », un « personnage », une « pétrification identitaire ». Et il lâche finalement à Didier Eribon qui parlent du nous homosexuels : « je ne comprends pas ce nous ». Cas réglé.
Cette attitude est générale : l’autre n’a pas le droit de dire pour lui-même son identité. Et cette fois-ci, il n’y a plus de brouillage et d’indéterminabilité sympathique. En théorie, Finkielkraut aime cette idée qu’on est défini par sa non-identité. Il aurait dû être queer ! Et pourtant, sous prétexte d’une distinction subtile entre pudeur et hypocrisie, Finkielkraut veut que les gays ne fassent pas « étalage de leur identité ». Et ils trouvent fasciste qu’on outte, qu’on dénonce les prélats catholiques gays qui condamnent publiquement l’homosexualité.
Son utilisation même de Foucault est – comme le lui signale Eribon – tout à fait contradictoire avec ce que Foucault lui-même en a dit. C’est le moment le plus fou de son incohérence. En tant qu’ami de Foucault (aucune biographie ne parle de lui, ils se sont rencontrés lors d’un dîner minable organisé par Mitterand au sujet de la Palestine et d’Israël en 1982) et lecteur, Finkielkraut rappelle qu’il ne faut pas céder à la logique de l’aveu, qu’il faut rester caché, et que dire le sexe serait déjà se soumettre au pouvoir.
Mais le « dispositif de la sexualité » n’est pas le dernier mot de Foucault. Quand il parle des gays, il faut lire les interviews de Foucault. De ce point de vue-là, c’est très clair.
Foucault est partisan d’une culture gay (« Je pense, quant à moi, que nous devrions comprendre la sexualité dans l'autre sens : le monde considère que la sexualité constitue le secret de la vie culturelle créatrice ; elle est plutôt un processus qui s'inscrit dans la nécessité, pour nous aujourd'hui, de créer une nouvelle vie culturelle sous couvert de nos choix sexuels », in «Michel Foucault, an Interview : Sex, Power and the Politics of Identity» («Michel Foucault, une interview : sexe, pouvoir et la politique de l'identité» ; entretien avec B. Gallagher et A. Wilson, Toronto, juin 1982 ; trad. F. Durand-Bogaert), The Advocate, no 400, 7 août 1984, pp. 26-30 et 58., Dits et Ecrits tome IV texte n° 358).
Et Foucault est partisan d’une identité gay (« Nous avons donc à nous acharner à devenir homosexuels et non pas à nous obstiner à reconnaître que nous le sommes »«De l'amitié comme mode de vie», entretien avec R. de Ceccaty, J. Danet et J. Le Bitoux, Gai Pied, no 25, avril 1981, pp. 38-39. Dits et Ecrits, tome III n°293).
rien à voir, mais Russel Brand me fait toujours marrer.
L’identité nationale.
Mais on ne peut pas faire l’analogie entre le processus d’identification minoritaire ou individuel et celui d’une nation toute entière. Finkielkraut avait d’ailleurs été rappelé à l’occasion par Philippe Mangeot (dans la même archive INA que j’ai précédemment cité). En voulant dire que la communauté LGBT exclut et qu’à l’échelle des nations « cela donne le nationalisme », Philippe Mangeot lui réplique qu’il n’y a rien de comparable, puisque la nation ne peut pas être minoritaire par rapport à elle-même. Aha…
Le « scandale théorique » de l’analogie entre identité minoritaire et identité nationale a d’ailleurs été si bien compris intuitivement par les Français, qu’il n’a pas pu avoir lieu une deuxième fois. Et le débat lancé par l’UMP en 2010 sur l’identité nationale échoue probablement pour cette même raison. Le français qui se sent moche, rejeté et incompris comme Shrek ne peut plus retourner le stigmate si tout le monde habite le même marais et a la même peau verte (comme c’est le cas dans le début de Shrek 2).
La solution à l’identité nationale est donc assez inédite. En reprenant la fameuse citation de Rosenzweig, on pourrait dire que si la question de l’identité nationale est universelle, la réponse qu’en a donné Finkielkraut est juive. Attention, je ne cherche pas ici d’origines secrètes ou de complot ! Et je ne fais surtout pas de procès d’intention. Je trouve au contraire génial qu’enfin Finkielkraut admette qu’il y ait ici quelque chose de singulier, lui qui n’arrête pas le reste du temps de jouer les grands saints républicains. Finkielkraut s’inspire directement de ce qu’il appelle la « spiritualité juive » pour dire cette identité. Il défend cette position de façon si consciente qu’il le dit y compris lorsqu’on lui parle de mariage gay.
Hé, ne vous tapez pas toute l'interview, ça devient juste fou à partir de la huitième minute...
Là encore, l’une de ses sources est Lévinas. Le passé qui constitue cette identité est en tout cas évoqué sur le mode de la dette littéraire.
Ses interventions condensent parfaitement cette thèse :
1) Le passé est une dette, un devoir, dont on doit s’acquitter (pourquoi le passé aurait-il en soi une valeur ? Et quel passé ? ça, je n’ai pas réussi à bien le comprendre).
2) cela détermine l’éducation à être essentiellement une transmission de ce passé (encore une fois : pourquoi le passé aurait-il en soi une valeur ? Et quel passé ?).
3) Par passé, Finkielkraut entend d’abord le texte, les livres, qui sont à lire et relire encore, à mâcher et remâcher encore (ça c’est du Lévinas).
4) Par conséquent l’identité se construit d’abord comme une attitude intellectuelle de lecture des textes. Ce que Benny Lévy explique à Alain Finkielkraut comme étant la disposition constitutive de la spiritualité juive. « À la croyance, à l’intimité, à ce qui se passe dans le cœur, à l’intentionnalité même, le judaïsme oppose le double régime de l’étude et de l’observance. Na’assé ve‑nichma : “tu feras et tu entendras” ».
Et je veux l’écrire quelque part, je trouve cette façon de dire l’identité parfaitement cool et géniale. Mais elle n’est qu’une réponse singulière.
C’est la beauté de la phrase de Rosenzweig : « la question et d’ordre universelle, la réponse est juive ». En aucune façon, cette proposition identitaire ne peut valoir de façon universelle. Or, c’est justement ici que ça dérape. Car cette réponse est la seule réponse de Finkielkraut. L’identité ne peut fonctionner que sur ce principe : soit il y a des profs de littérature, soit il n’y a pas d’identités. Et il y a pire car selon Finkielkraut, la démocratie toute entière est hostile à cette réponse (cf son intervention youtubée à la Procure).
Ce qui a motivé cet article, au fond, est très simple. Si je mets de côté la colère que suscite chez moi les positions de Finkielkraut à l’égard de la communauté LGBT et l’ignorance délibérée qu’il affiche à l’égard des positions (beaucoup plus subtiles qu’il ne les présente) de Butler et de la queer theory. Ce qui m’épuise profondément dès que le je vois, c’est qu’alors qu’il se présente comme le chevalier de la singularité qui résiste à l’universel inclusif (position proche de celle de Benny Lévy, de Lévinas, et en fait de toutes les minorités un peu conscientes de leur histoire – et donc de la mienne), il renie aussitôt cette position pour dire à tout le monde ce qu’il doit faire du haut de son piédestal républicain. Finkielkraut incarne mieux que quiconque la mauvaise foi – mais républicaine celle-là.




/idata%2F2753872%2FMadmen%2FR%2Fmadmen.jpg)
/idata%2F2753872%2Fmariage%2FMariage_Daumier_Republique.jpg)
/image%2F0573637%2F20140510%2Fob_f733d6_butler-ces-corps-qui-comptent.jpg)
/idata%2F2753872%2Fpornosophie%2Fmanara.jpg)



/image%2F0573637%2F20140429%2Fob_b039b8_finkielkraut-langue-2.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fthumbnail%2Fvideo%2Fxddsr6_badiou-finkielkraut-debat-part4_webcam)
/idata%2F2753872%2Fcanto-sperber%2Fb-boy-vader-342217-475-633.jpg)

/image%2F0573637%2F20140513%2Fob_e346ca_banshee.jpg)
/idata%2F2753872%2Fpiscine.jpg)
/idata%2F2753872%2F%2Ftmylm1.jpg)
/idata%2F2753872%2FNT%2Fnip-tuck-acteurs.jpg)
/idata%2F2753872%2FLost%2Fhurley.jpg)

/image%2F0573637%2F20140223%2Fob_adc12d_trent-reznor.jpg)
/idata%2F2753872%2Fholophone%2Fflashdance-29400.jpg)
/image%2F0573637%2F201310%2Fob_f19cd0a8403c38c1c9d6d1ac9feef7b0_hr1.jpg)
/image%2F0573637%2F201309%2Fob_6bb594e8e6a08e7878fd745f6359d184_mymaio.jpg)

/image%2F0573637%2F20140716%2Fob_fcb16c_finkielkraut-russelbrand.jpg)




/idata%2F2753872%2FNT%2Fniptuck.jpg)
/idata%2F2753872%2FMadmen%2FR%2Fdraper_bureau.jpg)



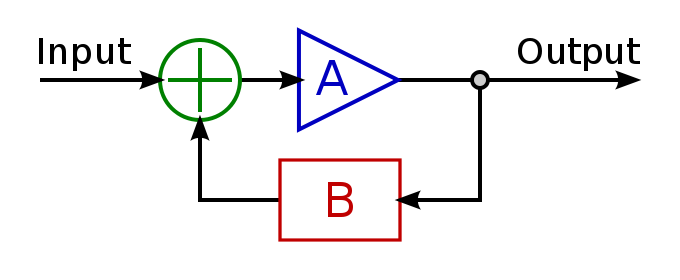

/idata%2F2753872%2FIA%2F2001finhall.jpg)
/idata%2F2753872%2FD9%2Faliend9.jpg)
/idata%2F2753872%2Fblockbuster%2FBlockbuster_bombe.jpg)
/idata%2F2753872%2Fvideogame%2Favengers_video.jpg)



/idata%2F2753872%2Fsexydoxo%2Fburqa-marilyn.jpeg)
/idata%2F2753872%2FContreculture%2Frevolte_couverture.jpg)
/idata%2F2753872%2Fmariage%2FMariage_img-5-small580.jpg)
/idata%2F2753872%2Fsarko_t-l-phone.jpg)